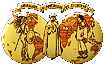|
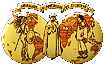                               
| |
 cliquer sur l'image
cliquer sur l'image | Auteur(s) | Francis
JACQUES |
Titre | De
la Textualité. Pour une textologie générale et comparée. |
Description
|
Paris, 2002,
in-8° br., 240 pages.
| ISBN : 2-7200-1141-X |
–
|
Dim : 21,70
x 13,70 x 1,50 cm
|
–
|
Poids : 315
g
|
–
|
Prix : 23
euros
|
| Collection |
Itinéraires
poétiques, Itinéraires critiques.
Collection dirigée par Daniel-Henri Pageaux (Sorbonne Nouvelle)
et Sobhi Habchi (CNRS-CRAL-EHESS).
|
Commentaire
|
Le texte n'est pas un simple objet
qu'une discipline positive pourrait
annexer. Comme la textualité donne corps et corpus
à la pensée, une réflexion philosophique
est recommandée au plan de l'originaire - comme naguère l'histoire,
l'altérité, ou le travail.
Le texte ne " serait qu'un pauvre petit tas de feuilles sans vie,
n'était ce grand mouvement qui parfois s'en empare ". Comme un tel
mouvement n'est pas dépourvu de structure, la vieille opposition
entre genèse et structure est surmontable. Ce que le lecteur doit
appréhender, c'est une structure dynamique et singularisante :
où va le poème ? Où va le philosophème ?
La plupart des auteurs font jouer le texte poétique dans le voisinage
de la mystique et de la philosophie. On élargira ce jeu structural.
Un seul type de textes n'a pas charge de transformer la pensée de
la pensée. Il est de la responsabilité du philosophe de pratiquer
une interrogation ultime qui est tout autant au défi du théologoumène
ou du "théorème" que du poème.
Que comparons-nous en confrontant le philosophe Nietzsche et le
romancier Mishima ? La différence des oeuvres s'enracine dans la
différence érotétique (Littré:
"concerne l'interrogation") de leur rapport à l'inconnu. Certains
traits différentiels recommandent l'ouverture du souci comparatiste
à une textologie comparée. Nous
avons mis la textualité devant la philosophie, non sans que la philosophie
n'ait été mise devant la textualité.
 |
Francis JACQUES, professeur
émérite à l'université de la Sorbonne Nouvelle, est lauréat de l'Académie
Française et de l'Institut, Membre de l'Académie d'Éducation et
Sciences Sociales.
|
Sommaire
|
~ Prologue : Le niveau
philosophique de la question - La lutte des paradigmes - Modes d'interrogation,
types de textes
~ Chap.
I Le texte poétique : Ainigma :
Quand l'oscillation de sens est non résolue - Quand l'allusion
couvre l'angoisse - Deux cas limites: le féerique et le fantastique
— Vers la clef érotétique :
Une interrogation encore dans le poème ? - Interrogation
existentielle et problèmes formels - Notion de style d'interrogation
— L'énigmatisation du mystère.
~ Chap.
Il Rendre au texte de fiction sa référence : Quand l'oscillation
du sens est en voie de résolution - Comment assurer l'enjeu référentiel
? — Le problème de la fiction,
ses solutions indésirables : Un usage fictionnel du
discours ? - L'ordre du "comme si" ? - Le pouvoir de refiguration
du monde — Notion de référence
suspensive : Une modélisation de secours : "les
mondes possibles" - Référence et interrogativité.
~ Chap.
III L'argumentation des philosophes : Un processus de
validation typique ? - Effets textuels et postulat d'invariance
argumentative — Sur l'opposition
avec la rhétorique : Qu'en est-il de l'auditoire universel
? - Le caractère métadiscursif —
La visée heuristique : Un questionnement de type informel
- Les questions philosophiques - Une quête radicale — La
question des paradigmes.
~ Chap.
IV : L'impact philosophique de la condition de textualité :
Interrogativité et textualité - Stratégique, systématique,
problématique — La textualisation
des concepts : Une tâche indéclinable - Distribuer et
articuler.
~ Chap.
V Qu'est-ce qu'un texte religieux ? : Sites multiples
— A la recherche de critères :
L'Ecriture ou la Parole ? - Niveaux d'analyse et critériologie
— De la forme de vie à la
force de vie : Textualisation et interrogation - Paraphrase,
commentaire, interprétation - Le Livre (plusieurs fois) vivant.
~ Chap.
VI Comparer les textes, les types de textes : Que comparer
? - Pertinence textuelle de la notion de présupposition - Interroger
et interpréter — Sur un
privilège : Le cas du texte scientifique - Rivalité
aux frontières de l'inconnu - Quid de la relation à l'absolu ? —
Sur la possibilité d'un "passage" :
Les grands hybrides textuels en question - Trans-textualité,
réductions et reprises - Une lutte folle pour la possibilité.
~ Chap.
VII Le Texte, l'oeuvre, le livre : Les
modes d'excellence : Evaluer - La fonction auteur -
Cela fait trois critiques.
~ Epilogue :
Qui est l'ami du texte ? — Quelle proposition d'existence
? — La question de l'humain dans l'homme.
~ Index nominum — Glossaire
|
|
Du même auteur
| — |
Autres ouvrages
sur le sujet | — |
|